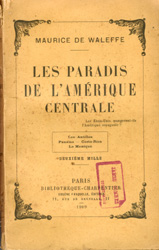COSTA RICA
Le premier tribunal international.
- Comment on voyage. - Un embarquement laborieux. - Un bateau
où il y a des Chinois, des rats et des cafards.
La plus belle forêt du monde. - La république
des oiseaux. Les vraies montagnes de l'orchidée.
- La capitale du Costa-Rica est un village - La Costa-Ricienne
a toujours l'air d'aller au bal. - Une selle qui tourne
à propos. - On se marie à minuit. - Un curé
qui a sept filles.
Pourquoi la guerre est-elle endémique? - Des carrosses
pleins d’officiers français. Les 500.000 francs
de M. Carnegie. - Les lavements du général
Zélaya, président du Nicaragua. - Un attentat
contre Cabrera, président du Guatemala, - Un président
qui ne savait pas lire. - La Balançoire de Fragonard.
_ Un pantalon ... - L'affaire du curé Pagès.
Un théâtre de dix millions où l'on ne
joue jamais. - Des madones du Pérugin. - Un roman
un Costa-Rica. - La conquête de toute l'Amérique
centrale par le Yankee est l'affaire d'un quart de siècle.
- Cinq mauvais cochers. _ La vie de château manque
d'agréments. - Un des paradis de la race blanche.
Les
cinq républiques de l'Amérique centrale, à
savoir, en remontant du Panama au Mexique: le Costa-Rica,
le Nicaragua, le San-Salvador, le Honduras et le Guatemala,
viennent de prendre une décision qui prouve à
la fois l'écrasante pesée des États-Unis
sur ces pays et le désir qu'éprouvent ceux-ci
d'opposer, bloc à bloc, le bloc de l'Amérique
latine à celui de l'Amérique anglo-saxonne.
L'Europe
ne saurait se désintéresser de cet épisode
d'un duel gigantesque. Le jour où le Yankee parlera
en maître depuis le Canada jusqu'au détroit
de Magellan, ce jour-là verra la fin de toute espèce
d'entreprise ou d'importation européenne. Londres,
Anvers, Hambourg, Bordeaux, Gênes, auront reperdu
le Nouveau Monde.
Pendant
trois siècles, les Espagnols capturèrent tout
navire étranger assez hardi pour aborder dans leurs
colonies d'outre-mer. La tempête même, qui jette
les vaisseaux hors de leur route, n'était pas une
excuse, et l'équipage allait pourrir en prison. Les
Yankees n'auront plus à employer ces rigueurs. De
nos jours, un simple tarif douanier suffira à balayer
de l'Atlantique tout autre pavillon que le pavillon étoilé.
Cette perspective vaut bien une minute d'attention.
Donc,
les cinq États minuscules, qui voudraient échapper
au sort de Panama, inaugurent ces jours-ci un embryon de
fédération, tout au moins morale, en fondant
au Costa-Rica, le plus avancé d'entre eux, une Cour
suprême de justice, une sorte de Tribunal des Amphictions,
dont toute l'Amérique centrale se déclare
désormais justiciable. Les États-Unis ne s'opposent
point à la création de cet organe fédéral.
Ils voient une arme à leur usage là où
les Centre-Américains voient un bouclier contre eux.
L'avenir dira qui a vu le plus juste.
Pour
assister aux grandes fêtes qui vont marquer l'inauguration
de cette Cour suprême dans la capitale du Costa-Rica,
j'ai quitté précipitamment Panama. Il ne s'agissait
que de passer comme qui dirait de Belgique en Hollande.
Seulement on ne passe pas à travers les forêts
sauvages qui couvrent l'isthme. Il faut faire le tour par
les côtes. Un petit voyage de deux jours, mais opéré
dans quelles conditions et exposé à quels
hasards !
Comme
ces mêmes difficultés se reproduisent plus
ou moins dès qu'on veut aller ici d'une capitale
à la capitale voisine, et qu'elles constituent le
plus sérieux obstacle à la constitution d'un
vaste État central, elles méritent d'être
contées.
Costa-Rica,
comme Panama, occupant toute la largeur de l'isthme, possède
un port sur le Pacifique et un port sur l'Atlantique. Mais
ce dernier seul est réuni à sa capitale intérieure
par un chemin de fer continu. Il me fallait donc, tout d'abord,
traverser l'isthme de Panama pour retourner m'embarquer
à Colon, le jour où partirait de ce port un
bateau à destination du Costa-Rica.
Ce
jour-là, le train quittant Panama à six heures
du matin, je ferme à peine l'œil, n'ayant aucune
confiance dans le nègre qui a promis de me réveiller.
Malheureusement, ce sont aussi des nègres qui doivent
porter mes bagages à la gare. Avec les nègres,
il n'y a pas de surprise; on sait d'avance que tout ratera.
En effet, ils viennent prendre mes colis à la dernière
minute, et le train file sous mon nez.
Hélas!
le bateau de Colon pour Costa-Rica lèvera l'ancre
sans moi ! Il me faudra attendre celui de la semaine suivante
... Non! J'apprends qu'un second train qui part quatre heures
plus tard peut encore arriver avant le départ du
bateau. Mes nègres me jurent que j'aurai une grande
demi-heure pour passer du train à l'embarcadère,
qui est à deux minutes de la gare. Allons! Courons
la chance! Si je manque le bateau, j'en serai quitte pour
rentrer le soir à Panama; le trajet de l'isthme en
railway est à si bon marché! Le port de mes
bagages ne me coûte que quatre-vingts francs pour
75 kilomètres. C'est pour rien!
Les
dieux soient loués! J'arrive à Colon à
une heure. Le bateau part à une heure et demie. Mais
il est interdit de prendre ses billets à bord. Il
faut les aller chercher à l'agence de la Compagnie.
J'y cours, tandis qu'un gentleman nègre, souriant
jusqu'aux oreilles entre les pointes d'un gigantesque faux-col,
m'engage sa parole d'honneur, en trois langues - en anglais,
en français et en espagnol - que mes malles vont
passer du wagon sur le bateau comme s'ils étaient
portés sur l'aile d'un zéphir.
Pour
qui s'étonnerait du rôle que jouent mes bagages
dans mes préoccupations, il faut dire que, dans toute
l'Amérique latine, on ne trouve que des articles
importés d'Europe à grands frais par des commerçants
qui acquittent des droits de douane affolants et qui prétendent
encore, par là-dessus, faire fortune en trois ans.
C'est ainsi qu'au Chili, on achète une paire de souliers
pour soixante-quinze francs. A ce prix-là, on tache
de ne pas semer ses bottes en route!
A
l'agence de la Compagnie de navigation, il suffit de débourser
de l'argent, opération qui ne souffre beaucoup de
délai en aucun pays. Me voici paré, et je
fais d'un pied allègre les cent pas sur l'embarcadère,
attendant mon commissionnaire nègre, son triple faux-col,
sa triple parole d'honneur et ma triple montagne de bagages.
Le
bateau pour Costa-Rica se balance impatiemment au bord du
quai. C'est un bateau fruitier, destiné au transport
des bananes. Les passagers ne sont admis que par surcroît.
Il est tout petit et plutôt sale. Ses rares cabines
sont occupées. Le capitaine m'explique en quatre
langues - une de plus, parce qu'il est Norvégien
- que, sous les Tropiques, on se trouve fort bien de dormir
sur le pont.
Soudain,
il se met à pleuvoir. Entendez par là qu'en
deux minutes j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, et que la
ruelle par où doivent déboucher mes infortunés
bagages se change en torrent impétueux. Du coup,
je suis perdu. A moins d'être traînée
par des dauphins, comme la conque d'Amphitrite, la charrette
de mon nègre ne pourra plus quitter la gare. D'ailleurs,
le bateau va lever l'ancre. Je suis perdu. Le capitaine
norvégien exprime l'opinion que mon gentleman nègre
était peut-être un voleur ... Il aura caché
mes malles dans le quartier nègre de Colon, quartier
tellement sale que ses ordures lui font un rempart infranchissable.
Là vit une extraordinaire population de bandits,
l'écume des quatre coins du monde ...
Il
pleut de plus en plus; on ne peut nommer cela de la pluie.
C'est un second Océan, situé dans les nuages,
qui se déverse sur les quais avec le fracas de quarante
Niagaras. N'ayant plus l'espoir de partir avec mes équipages,
je fais débarquer les menus colis déjà
entassés sur le pont.
On
me rejette donc, du haut du bord, mes valises et une caisse
à papillons, où ces lépidoptères
sont épinglés sous verre. On m'avait bien
recommandé, quand je visiterais Panama, d'emporter
une collection de papillons. On ne saurait trop recommander
aux voyageurs en Amérique d'acquérir force
collections de papillons. C'est si commode à transporter!
Miracle!
Voici mes malles ! Un animal fabuleux, qui dresse au-dessus
du torrent la tête d'une mule mais qui a peut-être
des nageoires sous le ventre, traîne la charrette
où je puis voir mes bagages les plus lourds empilés
sur les plus fragiles. Ma seule malle trouée - que
j'ai vainement essayé de faire réparer à
Panama _ a été soigneusement placée
au sommet de la pyramide, de façon à recevoir
toute l'eau du ciel. Pour tant d'ingéniosité,
mon gentleman nègre à faux-col, qui n'a qu'une
heure de retard, me réclame la modeste somme de cent
francs. C'est toujours pour rien: célérité
et discrétion! Payons et embarquons, puisque cette
pluie providentielle a retenu le bateau près du quai!
La
pluie cesse. Nous partons. Ouf! Je n'ai perdu que ma caisse
à papillons et sans doute le contenu de ma malle
trouée, deux colis sur une vingtaine, à peine
du dix pour cent. A ce compte-là, je puis visiter
une dizaine de villes américaines avant d'être
absolument sans ressources.
La
mer est calme. Heureusement ! Car nous sommes soixante passagers
dans un « salon » destiné il en contenir
six ou sept. Si le mal de mer s'emparait de ce troupeau
humain, ce serait intenable. Il n'y a pas de classe distincte.
Au souper, l'ouvrier mon voisin, qui doit exercer dans la
vie civile un métier très salissant si j'en
crois ses mains et son col de chemise, boit son café
dans sa soucoupe et s'essuie les doigts à la nappe.
Pour la nuit, on me découvre un lit dans une cabine
déjà occupée par trois Chinois. Très
propres, ces Chinois, et ne sentant pas l'opium ! Néanmoins,
la chaleur de ce lieu privé d'air est telle que je
fonds sur ma couchette. Sous peine de disparaître
de ce monde en ne laissant d'autre trace de mon passage
qu'une petite mare d'eau, je m'arrache à cet asile
et remonte à l'air libre, où souffle une brise
assez traître. On est prié de rester éveillé
si l'on ne veut attraper la fâcheuse pneumonie. Une
lune splendide éclaire sur le pont les ébats
innocents des rats et des cafards.
Au
petit jour, on jette l'ancre devant une côte basse
tout empanachée de palmiers: c'est la côte
du Costa-Rica. A gauche, un îlot arbore le pavillon
jaune de la Santé. C'est là qu'on subit la
quarantaine. Chaque port d'Amérique est ainsi flanqué
d'un lazaret où, une fois sur deux, les passagers
courent le risque de passer une semaine d'isolement, propice
à de pieuses méditations, mais peu faite pour
abréger la durée des voyages.
Un
heureux hasard veut que mon bateau n'ait touché à
aucun port suspect. Je puis donc prendre pied à terre,
payer les droits de douane, payer les porteurs de mes bagages,
payer le chemin de fer et m'installer enfin dans le wagon
qui me mettra ce soir à San-José, capitale
de la République de Costa-Rica! Cependant le chef
de gare me prévient charitablement que, la pluie
ne cessant de tomber depuis huit jours, la ligne est probablement
endommagée en plusieurs endroits, et que j'ai peu
de chances de parvenir à destination.
J'en
fus quitte pour la peur. Je suis arrivé à
San-José ; et je dois dire, avant d'aller plus loin,
que tout le monde s'y extasie sur le bonheur extraordinaire
avec lequel j'ai fait mon petit voyage.
*
* *
Je
n'ai point vu l'île de Ceylan, qui passe pour le plus
beau lieu de la terre, mais je doute qu'elle dépasse
en splendeurs le panorama où serpente le chemin de
fer du Costa-Rica. En comparaison de celle-ci, la forêt
que j'ai traversée la veille sur le chemin de fer
de Panama n'était qu'une vulgaire brousse.
On
commence par rouler le long de la mer entre des allées
de palmiers royaux comme n'en possède aucun jardin
botanique. Puis apparaissent toutes les essences tropicales,
- je ne vous les énumérerai pas: il y en a
deux mille deux cents ! - arbres aux fûts colossaux
dont les frondaisons démesurées, à
cent pieds dans les airs, laissent pendre ces écheveaux
do lianes floconneuses et argentées que l'on appelle
ici : « Barba de viejo » (Barbe de vieux). Rien
ne peut dépeindre la hardiesse et la grâce
dos grottes de verdure où se suspendent ces stalactites
végétales.
Cette
forêt fastueuse n'a pas de bornes. Elle tapisse les
vallées, drape les montagnes de toutes les nuances
du vert, piqué çà et là par
la note rouge ou jaune d'un bouquet d'arbres en fleurs,
et ne se perd que dans les hauteurs du ciel bleu-pâle.
Nous sommes à la saison des pluies. Un fin brouillard
endiamanté éteignait les couleurs, qui eussent
pu être trop vives, de cette nappe d'émeraude.
Le vol brusque d'un oiseau de rubis ou de topaze allumait
parfois dans ce voile humide le feu d'une pierrerie. Quel
décor de théâtre !... si les décors
de théâtre étaient autre chose que du
papier peint. Les vraies forêts ignorent la comédie
humaine. Celle-ci murmure au vent et s'épanouit dans
la lumière, aussi ignorante du ruban de voie ferrée
qui la traverse que des boas qui se coulent entre ses herbes.
J'ai
parlé d'oiseaux. S'il fallait trouver un pays du
monde où placer cette République Iles Oiseaux
que, d'Aristophane à M. Edmond Rostand, tant de poètes
ont rêvée, Costa-Rica en serait la patrie indiquée.
Ce territoire minuscule abrite sept cents espèces
d'oiseaux, deux fois plus que l'Europe entière. Le
plus grand est l'aigle blanc. J'avoue ne l'avoir aperçu
qu'au musée de la capitale. Mais il a l'air tellement
méchant que, même empaillé, il m'a fait
peur. Le plus mignon est un oiseau-mouche gros comme la
moitié d'une aile de papillon. Le plus splendide
est le « quetzal », cet oiseau vert au ventre
écarlate qu'une république voisine, le Guatemala,
a adopté pour emblème, parce qu'il ne peut
vivre qu'en liberté et meurt sitôt qu'on le
met en cage.
Vous
remarquerez que je ne vous parle point d'orchidées,
bien qu'elles abondent et que nous soyons encore à
l'époque de leur floraison.
C'est
que l'orchidée, fleur rare d'une plante parasite
qui croît sur les plus hautes branches des arbres,
ne produit aucun effet dans un paysage. On ne la voit pas.
Ce bijou floral, chef-d'œuvre du céleste orfèvre,
semble avoir été ouvré pour s'épanouir,
un soir de bal, entre les deux seins d'une jolie femme.
Cc sont là ses montagnes, les seules qui conviennent
ù sa délicatesse.
Toute
la région basse du Costa-Rica est inhabitée.
Ce paradis terrestre nourrit encore cent trente espèces
de serpents, mais Adam et Ève l'ont fui. Il faut
dire qu'il est très malsain. Quand l'Église
catholique sera devenue résolument moderniste, ce
qui ne saurait tarder, en dépit de Pic X, et quand
on se préoccupera d'accorder la Bible avec la science,
ce ne sera plus un ange armé d'une épée
flamboyante qu'on peindra à la porte de l'Eden, ce
sera le moustique des fièvres paludéennes!
Cependant,
depuis que le Costa-Rica est devenu le principal fournisseur
de bananes des États-Unis, - au point qu'une compagnie
de bateaux-fruitiers, expressément créée,
transporte un million de « régimes »
par mois ! - les planteurs américains ont amené
quelques nègres de la Jamaïque et leur ont bâti,
le long de la voie ferrée, des maisonnettes en tôle,
d'où ces grands noirs ù l'âme enfantine
regardent passer Je train en riant aux éclats. Déjà
les maisonnettes sont submergées par les hautes herbes
et noyées sous les palmes retombantes. Sur les lianes
suspendues aux façades, des perroquets verts se balancent
en jacassant comme s'ils se moquaient du monde.
Et
le passage du train fait accourir des pelotons de négrillons
tout nus, au ventre rebondi; ils pataugent sous la pluie
tiède, nous tirent la langue, nous jettent des pelures
de bananes, tandis que leurs mères portent sur la
tête des corbeilles d'ananas qu'elles nous offrent
avec un large sourire.
Quand
le train abandonne ces plaines enchantées pour s'élever
dans la région montagneuse où est bâtie
la capitale du pays, on quitte les paysages de Ceylan pour
ceux du Caucase ou de l'Engadine. C'est encore très
beau, quoique plus familier à un œil européen.
La voie franchit les torrents et les précipices sur
des ponts Je fer vertigineux. Ici s'arrêtent les bananiers
et les nègres. Là commencent les plantations
de café et la population indienne.
Peu
à peu, ça se gâte. La végétation
se clairsème. De grands plateaux pierreux étendent
leur aridité mélancolique entre de trop rares
prairies qui n'ont plus rien d'exotique. C'était
bien la peine de faire trois semaines de mer pour retrouver
ici les paysages de l'Ardenne ou de la Bretagne ! Hélas
! La lumière devient de plus en plus grise. Des cimes
rocailleuses emprisonnent maintenant l'horizon, couchant
mes illusions dans un cercueil de pierre, sous un ciel de
plomb. J'évoque mes plus mauvais souvenirs de Norvège.
La
capitale du Costa-Rica est une déception. Son magnifique
chemin de fer aboutit à un village de vingt-cinq
mille paysans, perdu dans la montagne. C'est San-José.
Quel farceur m'avait dit que les maisons y disparaissaient
sous les roses ? Ce sont sans doute les roses qui disparaissent
sous les maisons, basses et uniformes, ressemblant à
des habitations ouvrières. L'hôtel est une
auberge mal tenue.
Si
c'est là, ô Amérique centrale, la plus
belle de tes capitales, que seront les autres? Et que pourront
ces cités-pygmées contre les New York et les
Chicago colossales ?
*
* *
Rien
ne trompe comme la première impression d'une ville
nouvelle. Elle est rarement la bonne, la vraie, celle qu'on
emportera après un long séjour. C'est qu'au
premier coup d'œil on juge les habitations. II faut
plus de temps pour juger les habitants. Or, ceux-ci seuls
importent, à moins d'être architecte.
La
capitale du Costa-Rica se présente mal. Le nouvel
arrivant se met au balcon de la mauvaise auberge qui ose
s'appeler « Palace Hôtel », contemple
l'unique tramway dont le trolley dépasse le toit
des petites maisons basses, et aussitôt éprouve
un seul violent désir: celui de s'en aller !
Mais
réveillez-vous le lendemain dans la magnifique lumière
des hauteurs sous les tropiques, portez les lettres qui
vous ouvrent l'intimité de quelques familles distinguées,
appréciez l'humeur douce et riante du Costa-Ricien,
la grâce singulière de la Costa-Ricienne, la
température exquise, l'heureuse perspective des rues
qui s'ouvrent toutes sur des montagnes bleuâtres comme
des fonds de tableau, enfin la rare splendeur de l'heure
quotidienne où les nuages qui planent sur l'Atlantique
et ceux qui planent sur le Pacifique se réunissent
autour des Cordillères pour former, au-dessus du
soleil qui se couche, un dais de gloire ineffable, une invraisemblable
apothéose de fleurs et de flammes, et vous commencerez
à modifier du tout au tout votre première
impression. Au bout de trois jours, vous trouverez naturel
de passer ici le reste de votre vie.
La
ville est banale et presque laide, c'est entendu; on m'avait
dit que les maisons disparaissent sous les roses, c'est
une hourde; mais il serait vrai de dire que les rues s'y
fleurissent do jeunes filles qui ressemblent à des
roses, il des roses blanches, jaunes, rouges.
La
Costa-Ricienne qu'on aperçoit dans les rues a toujours
l'air d'aller au bal ou d'en revenir. Fût-ce à
neuf heures du matin, fût-ce dans la pluie et la houe,
vous ne la verrez jamais autrement qu'en souliers de satin
et en falbalas de mousseline blanche. Un long châle
rose tendre ou vert-d'eau lui drape les épaules;
une éclatante fleur rouge est piquée dans
ses épais bandeaux de cheveux noirs. Ainsi pavoisée,
elle promène par la ville un front joliment bombé,
deux yeux ardents et un petit museau plus fardé,
plus frotté de poudres, de crèmes et de couleurs
qu'une lorette des Folies-Bergère.
C'est
qu'elle fait à peu près le même métier.
Elle chasse à l'homme. Je me hâte de spécifier
que c'est pour le bon motif ! Elle chasse au mari. Au Costa-Rica,
il y a quatre filles pour un garçon. Celui-ci fait
prime ! Aussi est-ce lui qui doit se garder ù carreau,
et se défendre des pièges que lui tend un
sexe faible mais affamé. Quant à la jeune
fille, elle n'a qu'une idée: se compromettre 1 Papa
et maman interviendront alors et obligeront l'auteur du
scandale à le réparer.
J'assistai
hier à un mariage de ce genre. Le scandale de rigueur
s'est produit durant une excursion à cheval. La jeune
fille, à certain moment, resta en arrière
de la caravane et appela son « novio » à
l'aide : la sangle de sa bête était desserrée
ct la selle tournait! Voilà le galant forcé
de prendre la belle à bras le corps pour lui faire
mettre pied à terre. Mais le frère de la jeune
fille veillait. Il accourt à francs étriers
et surprend-le couple enlacé. Cris ! Menaces! Provocation
en duel ! Tout cela a fini, comme dans les contes de fée,
par un mariage.
Et
notez que les gamines qui imaginent ces trucs compliqués
parfois n'ont pas plus de treize ans, âge légal
de l'hymen pour les filles ! La nécessité
est mère du génie.
Quant
au mariage précité, il s'est célébré
dans toutes les formes usuelles au Costa-Rica : on n'alla
pas à l'église, c'est le prêtre qui
vint à la maison et donna la bénédiction
nuptiale à minuit, dans le salon, en présence
de la famille et des invités. Les jeunes époux
échangèrent solennellement treize pièces
de monnaie, puis tout le monde se remit à danser
sous les guirlandes de fleurs et les - multicolores lanternes
japonaises. Voilà deux vies unies ... pour huit jours!
Car,
en général, la lune de miel ne dure pas davantage.
L'Espagnol, qui est le plus galant des fiancés, est
le plus volage des époux. Il court vite à
d'autres conquêtes. Je reverrai longtemps un vieil
hidalgo de ces pays que je visitais dans sa « finca
», comme on appelle ici les propriétés.
Je le félicitais sur sa verdeur.
-
Oui, me répondit-il en prenant sa femme par le bras
: j’ai eu trente-quatre enfants avec mon épouse
ici présente, et plus de quarante au dehors !
La
bâtardise n'est nullement une tare, et les enfants
naturels sont libres d'adopter le nom du père, tout
comme les légitimes. Ils sont absolument sur le même
pied. Il n'y a pas non plus de déshonneur à
être fils de curé.
Sauf
au Costa-Rica, où le clergé paroissial observe
une meilleure tenue, dans les autres républiques
chaque « padre » élève très
consciencieusement une petite famille pondue au hasard des
confessionnaux. On me cite un curé du Nicaragua,
très riche, qui a doté somptueusement ses
sept filles et vieillit comme un patriarche de la Bible,
entouré du respect universel. Ayant droit aux prémices
de la culture et du bétail, personne ne se scandalise
s'il s'arroge aussi les prémices de son troupeau
pastoral. Un proverbe courant dans l'Amérique espagnole
dit qu'il n'y a que deux bons métiers pour un homme
: président de la République ou curé
!
Avec
de pareilles mœurs, vous vous attendez sans doute à
ce que les lois soient très dures pour les femmes
? Pas du tout! Nul code européen n'est aussi libéral.
La femme mariée garde l'entière gestion de
sa fortune. Ouvrière, son mari n'a aucun droit sur
son salaire.
C'est
l'éternel sujet d'étonnement du voyageur en
ces pays neufs : ils ont encore les mœurs que l'Europe
n'admet plus depuis cent ans, et ils ont déjà
des lois que l'Europe ne votera peut-(1tre que dans un siècle.
Lequel
vaut mieux, de bonnes lois ou de bonnes mœurs? On fait
ce qu'on peut: à défaut des mœurs, c'est
déjà bien gentil d'avoir les lois !
*
* *
Pourquoi
la guerre est-elle endémique dans l'Amérique
centrale ?
Raison
de race. Raison de milieu.
La
race est batailleuse, étant issue du mélange
de deux sangs bouillants, celui des vieux Conquistadors
et celui des peuplades indiennes. Le milieu favorise ce
goût inné : les cinq petites provinces, sous
la domination espagnole, formaient la capitainerie générale
de Guatemala. Chacune nourrit la secrète ambition
de reconstituer le grand état isthmique à
son profit, en assujettissant les quatre autres. Dès
qu'elle se croit plus forte que sa voisine, elle intrigue
pour lui imposer un dictateur de son 'choix. De là
ces guerres sans fin.
L'excès
du mal appelle parfois le remède. La plus petite
mais aussi la plus sensée des cinq républiques,
celle de Costa-Rica, a proposé à ses sœurs
irascibles d'instituer un Tribunal de famille.
Les
deux puissants voisins du Nord, le Mexique et les États-Unis,
se trouvaient avoir un intérêt égal,
bien que contradictoire, à ce que la paix régnât
dans l'isthme : les États-Unis désiraient
en achever tranquillement la conquête économique;
le Mexique désirait enlever aux États-Unis
tout prétexte à occupation armée.
Ils
furent d'accord pour applaudir au projet, et envoyèrent
chacun un ambassadeur chargé de tenir le Tribunal
naissant sur les fonts baptismaux.
Ces
deux parrains viennent d'arriver, avec les cinq délégués
des républiques centrales, sur un modeste croiseur
de 3e classe de la marine yankee, qui devient, sous la plume
grandiloquente des journaux locaux, una nave gigantesca!
San-José,
pour recevoir ces ambassadeurs de paix, eut une idée
charmante. Au lieu de mobiliser l'armée du Costa-Rica
- dont l'effectif, il est vrai, ne monte qu'à cinq
cents hommes - on aligna les enfants (les écoles,
cinq mille bambins conduit, par leurs institutrices. Les
garçonnets, porteurs de petits drapeaux, étaient
proprets et bien vêtus. Les fillettes, un bouquet
de fleurs à la main, semblaient charmantes, plus
élégantes que dans bien des villes françaises.
Quant aux institutrices, c'étaient les jeunes filles
de San-José, et San-José est célèbre
pour la beauté de ses senioritas.
Les
magistrats de la Cour suprême arrivèrent en
des landaus impeccables. Tout au plus, pouvait-où
critiquer l'ampleur des armoiries peintes sur les portières.
Mais c'est la faute des armoiries du Costa-Rica, qui comprennent
plusieurs montagnes, un coin de mer, un trois-mâts
et un soleil couchant.
Derrière
venaient au grand trot plusieurs carrosses pleins d'officiers
français. J'aperçois pêle-mêle
des colonels d'artillerie, des capitaines de chasseurs,
des lignards et même le plumet de nos Saint-Cyriens.
Ma surprise est grande. Mais ces uniformes ne sont qu'un
hommage rendu par les officiers costa-riciens à nos
costumiers militaires.
Comme
ils sont minces et point trop abîmés par les
combats - le Costa-Rica est en paix depuis 25 ans, ce que
les journaux de là-bas appellent une paix immémoriale,
- ça leur va très bien.
Le
grand jour fut celui de l'inauguration solennelle, quand
l'ambassadeur américain annonça que M. Carnegie,
le milliardaire philanthrope, lui avait remis un chèque
de 500.000 Fr. pour bâtir à ce premier tribunal
d'arbitrage un temple digne de lui.
Hélas!
Le point difficile, pour la nouvelle Cour, ne sera pas de
rendre des sentences, ce sera de les appliquer.
Je
vois mal le général Zelaya, président
du Nicaragua depuis quatorze ans, - encore que la Constitution
nicaraguaise déclare le président élu
pour quatre ans et non rééligible! - je vois
mal M. Estrada Cabrera, président du Guatemala, tout
aussi inconstitutionnel, obéir à un jugement
de la Cour suprême qui leur déplairait. Ils
feront traîner la chose en longueur, rappelleront
leur délégué sous quelque prétexte,
et ne donneront plus signe de vie.
Les
Etats-Unis s'improviseront-ils les huissiers à verge,
les recors du Tribunal, et interviendront-ils à main
armée? Ce serait avoir hâté ce qu'on
voulait empêcher.
Il
faut connaître ces despotes centre-américains.
Le
président d'une de ces petites républiques
isthmiques moins populeuses qu'une grande ville d'Europe,
dès qu'il a réduit à l'obéissance
ou à l'exil la douzaine d'hommes énergiques
capables de lui disputer la toute-puissance, n'a plus à
compter qu'avec des créoles timides et isolés
ou des Indiens encore sauvages et ignorants. Ses actes les
plus illégaux ne le desserviront pas plus que ne
le servirait son culte scrupuleux des lois. Vertueux comme
coupable, libéral comme despotique, il a également
à craindre l'apparition d'un rival plus fort que
lui, et n'a à craindre que cela. Jusque-là,
il n'est limité par rien, il ne doit le respect à
rien, pas même aux biens et à la liberté
des étrangers, comme le prouve l'impunité
d'un Castro au Venezuela, dépouillant, exilant, emprisonnant
même des sujets américains, anglais ou français.
Et
Castro n'est pas seul à se moquer des diplomates
et des escadres! Il n'y a pas deux ans que le général
Zélaya, président du Nicaragua, incarcérait
des Américains du Nord et répliquait à
la réclamation du consul des Etats-Unis en l'expulsant
ignominieusement du territoire de la République,
sans autre forme de procès. Les États-Unis
ont nommé un autre consul et avalé l'injure
sans sourciller. Ils ne pouvaient déclarer la guerre
au minuscule Nicaragua. On ne prend pas un sabre pour tuer
une puce!
Ce général Zélaya, d'ailleurs, n'est
pas sans originalité. Je ne parle pas de son obstination
à garder le pouvoir en dépit de la Constitution.
Je ne parle pas davantage de son énorme fortune,
évaluée à cinquante millions, bien
que les honnêtes grisettes de Paul de Kock, «
qui s'achetaient des diamants avec leurs économies
», soient notablement dépassées par
cet homme d'ordre qui épargne cinquante millions
sur un traitement officiel de cent mille francs.
Banalités
que tout cela, en Amérique ! Personne ne s'étonne
que la veuve de Barrios, pauvre métis indien qui
mourut président du Guatemala, jouisse d'un douaire
de quinze millions de dollars. Même au Costa-Rica,
république pourtant modèle et proverbiale
pour la régularité des comptes officiels,
on me montrait hier un jeune sous-lieutenant qui vient de
toucher, à sa majorité, 'un héritage
de sept millions et demi.
-
C'est son père qui a fait cette fortune, m'explique-t-on.
-
Ah! Il était industriel?
-
Non. Il a été président de la République.
Donc,
senior Zélaya, président du Nicaragua, avec
ses quatorze ans de dictature et ses cinquante millions
d'économies, ressemblerait à tous les présidents
présents, passés et futurs, s'il ne se recommandait
par des procédés de gouvernement pittoresques.
Chaque
fois qu'une révolution éclate au Nicaragua,
en moyenne tous les deux ans, il prélève sur
les citoyens riches des « contributions volontaires.
» Quand les dits citoyens riches manquent d'enthousiasme
pour soutenir la bonne cause, il les fait emprisonner, ou
affamer dans leur maison, ou suspendre momentanément
par les pouces, tous procédés d'usage immémorial
en Amérique. Mais au général Zélaya
revient vraiment l'honneur d'un procédé nouveau
et savoureux.
En
1900, quelques propriétaires du Nicaragua, taxés
à cent et deux cent mille francs de « contribution
volontaire », ayant fait les mauvaises têtes,
il les réunit dans une caserne où les soldats
sous ses yeux leur administrèrent des lavements d'eau
glacée, au sel et au piment rouge, « pour leur
rafraîchir les idées », déclara-t-il
d'une petite voix douce. Car le général, instruit
en France, à Versailles, se pique d'une politesse
raffinée, n'élève jamais la voix et
n'emploie que les expressions les plus choisies.
Ceci
est d'ailleurs la caractéristique de ces petits despotes
américains. Ils sont bien élevés, causeurs
charmants. D'une première entrevue avec eux, on sort
ravi et confiant. Plus tard, on déchante. Pourtant
ce ne sont pas des monstres. Ils ne se permettent que les
cruautés tout à fait indispensables, et presque
jamais d'assassinat, sauf contre leurs ennemis déclarés.
D'humeur excessivement galante, ils jettent le mouchoir
à leurs sujettes, mais ce mouchoir contient plutôt
un billet de banque ou une faveur qu'une menace. Mieux vaut
douceur que violence! Telle est leur devise à tous,
depuis Castro, maître du Venezuela, jusqu'à
Estrada Cabrera, seigneur du Guatemala.
Cependant
ce dernier, à l'heure même où j'écris,
vient de faire exécuter un nombre indéterminé
de personnes, parmi lesquelles des dames de la meilleure
société. C'est qu'elles avaient conspiré!
On a essayé de l'assassiner. Alors le tigre, qui
s'amusait à égratigner, devient méchant
et mord.
Un
témoin visuel me décrit la scène :
Quelques
élèves de l'École polytechnique cinq,
disent les uns; sept, affirment les autres ont tiré
sur M. Estrada Cabrera, au moment où il passait devant
les troupes pour se rendre de son palais à une réception
diplomatique. Ils l'ont manqué parce que le porte-drapeau,
qui devait donner le signal du feu en inclinant l'étendard
devant le Président, soit maladresse, soit émotion,
l'inclina si brusquement, qu'il força le Président
à baisser la tête pour l'éviter. Tous
les conspirateurs avaient visé à la tête.
Toutes les balles passèrent au-dessus de M. Es¬trada
Cabrera, qui ne fut qu'éraflé à la
main par une balle perdue.
Les
dépêches officielles disent que le président
a fait exécuter les coupables. Elles oublient d'ajouter
qu'il a fait « décimer » l'École
polytechnique, en commençant par le colonel qui la
commandait.
Les
prisons regorgeaient depuis longtemps de détenus
politiques. Aussitôt après l'attentat, M. Estrada
Cabrera a envoyé l'ordre de les mettre tous à
mort, sans jugement.
Le
tyran déteste le bruit des armes à feu; ces
malheureux ont été poignardés. On en
a dépêché ainsi une soixantaine, comme
des bœufs. Le carnage s'est étendu ensuite à
des épouses, à des mères, à
des sœurs ... A l'heure actuelle, la capitale du Guatemala,
grande ville de 80.000 habitants, est livrée à
la terreur.
N'allez
pas prendre senior Estrada Cabrera pour un monstre ! C'est
un causeur charmant, exerçant sur tous ceux qui l'approchent
une véritable séduction. Seulement on essaye
de le tuer. Il tue. Ce sont les beautés du pouvoir
personnel.
Le
Guatemala en a vu de pires. Il a vu Ra¬faël Carréras
qui le gouverna trente ans, et qui ne savait pas lire. Quand
un diplomate étranger lui remettait une note écrite,
il la prenait et la parcourait à l'envers, avec le
plus grand sérieux.
Mais
surtout le Guatemala a vu Ruffino Barrios. Ruffino Barrios
restera le prototype du dictateur américain, d'un
courage extraordinaire et d'une ambition napoléonienne,
mais brutal, luxurieux, vite féroce.
Il
eut des plaisanteries un peu lourdes. Il faisait balancer
les femmes de ses ennemis dans des hamacs, mais en leur
donnant pour berceuse une vache qu'on avait dressée
à donner des coups de corne dans ce hamac.
Pour
Barrios, femme désirée, femme prise.
Il la faisait enlever par ses soldats. Une fois, le père
d'une jeune fille protesta un peu haut. Barrios envoya à
ce père le lendemain, comme preuve et trophée
de sa victoire amoureuse, un paquet de linge ensanglanté.
Rassurez-vous! Il ne l'avait pas tuée. C'était
simplement - en vérité, il faut me pardonner
de dire cela ... - son pantalon.
Un
soir, chevauchant à travers ses États, le
terrible président arrive dans le village d'un curé
espagnol nommé Pagès. Despote et curé
soupent en tète à tête. Barrios s'amuse
à scandaliser son hôte en blasphémant
la vierge et tous les saints du paradis. Le curé
se fàche. L'autre, qui avait toujours une cravache
à la main, lui donne de cette cravache sur la figure.
Mais le padre avait le sang vif. Il saute à la gorge
de Barries, le renverse et allait l'étrangler, quand
un soldat, attiré par le fracas de la vaisselle brisée,
accourt et tue net le curé d'un coup de fusil entre
les épaules. Ce soldat fut nommé général.
Barrios
gardait chez lui dans une armoire toute sa fortune. S'il
ouvrait cette armoire, on entrevoyait des montagnes de bank-notes
et, en guise de presse-papiers, trois ou quatre revolvers
chargés. Ça ne l'empêcha point de périr,
comme le curé Pagès, d'une balle dans le dos.
Au moment décisif d'une grande bataille contre la
république voisine de San-Salvador, il prenait la
tète d'une colonne d'assaut quand il tomba percé
d'un coup de feu qui ne venait pas des rangs ennemis.
On
ne peut se défendre d'une espèce d'admiration
pour ces gaillards qui, après tout, ne sont pas responsables
de l'anarchie sociale où ils ont grandi, qui se déclarent
lions parmi les loups, posent une patte royale sur l'assiette
au beurre, rendent coup de dent pour coup de dent, tiennent
tête pendant vingt ou trente ans à la meute
des carnassiers inférieurs, et finissent par aller
dévorer leur proie à l'écart, vieux
lions fatigués, pleins de gloire et d'ennui.
Seulement,
ce n'est pas avec ces tyranneaux à l'ancienne mode
que l'Amérique latine pourra lutter contre le formidable
joug économique des États-Unis.
*
* *
Pour
toutes ces raisons, je ne crois guère ail succès
du nouveau tribunal centre-américain.
Mais,
au point de vue des Costa-Riciens, il aura toujours eu un
premier résultat. Il leur aura permis d'ouvrir leur
théâtre!
Ce
théâtre fait à la fois leur orgueil
et leur désespoir: leur orgueil parce qu'il a coûté
dix millions, leur désespoir parce qu'il reste inutilisé,
faute de troupe.
Amoncellement
de marbre de Carrare, de bois précieux, de velours
et de dorures, il est presque trop beau pour une ville dont
les rues ne sont point pavées et dont les conduites
d'eau potable laissent à désirer. Il est surtout
trop beau parce qu'on n'y joue jamais. San-José n'est
pas précisément sur l'itinéraire des
troupes de passage, et la dernière représentation
remonte à dix-huit mois !
Aussi
a-t-on saisi avec joie cette occasion-ci pour y donner un
grand bal, qui fut, ma foi, extrêmement élégant.
On se fùt cru à Paris, et l'on était
dans une petite ville de 25.000 âmes, mais de quelles
âmes ardentes à se consumer! Ce doit être
une question d'altitude. Sur le sommet du Mont-Blanc, l'eau
bout au-dessous de cent degrés .....
Les
Costa-Riciennes, dont j'avais déjà admiré
le costume original dans les rues, m'apparurent cette fois
vêtues en Parisiennes et dans tout l'éclat
de leur beauté. Leur tête, petite, est allongée
comme celle des statuettes de Tanagra, mais l'ovale du visage,
le nez mince, les arcades sourcilières bombées,
les paupières long fendues sur les noires prunelles
ardentes, rappellent les vierges de l'école d'Ombrie,
les Madones brûlantes et langoureuses du Pérugin.
Ces
femmes savent aimer. Sur le train qui descend de San-José
vers l'Atlantique, je rencontrai un couple élégant
et noble, portant le plus beau nom du pays, lui grand et
mince, le nez busqué, le masque énergique,
elle fine et blonde, ce qui est très rare ici. Ils
descendirent à une gare du parcours, d'où
l'on me montra la tour de leur castel, au loin, dans la
montagne, une propriété superbe, mais très
isolée. Certes, il faut s'aimer d'amour pour vivre
là toute l'année en tête-à-tête.
C'est leur cas. On me raconte le roman de leur mariage.
Elle
l'adorait depuis l'enfance. Lui menait une vie de jeune
seigneur un peu fat, point soucieux de se fixer trop vite.
Arrive dans le pays certain millionnaire du Honduras, qui
tombe amoureux de la jeune fille. Celle-ci le refuse d'abord,
comme elle refusait tous les prétendants; mais sa
famille insiste, lui représente sa jeunesse qui passe,
l'ingrat qui la dédaigne toujours ... Bref, elle
se résigne.
Arrive
la soirée du mariage (car je vous ai dit qu'on se
marie à minuit au Costa-Rica). Toute la ville était
invitée. La promise seule fit défaut. Sa famille,
atterrée, dut avouer qu'elle se refusait à
sortir de sa chambre et présenter force excuses aux
invités. Ceux-ci se retirèrent, on devine
dans quelle agitation. Le lendemain leur réservait
une bien autre surprise, car la fiancée de la veille
se mariait, mais avec un autre homme, avec celui qu'elle
avait toujours aimé!
Voici
ce qui s'était passé: à la dernière
minute on avait apporté un bouquet de fleurs du grand
dédaigneux. Dans ce bouquet, un billet: « Si
vous m'aimez toujours, n'épousez pas le Hondurien!
Je suis prêt à vous prendre pour femme ».
En
lisant ce billet, l'amoureuse tomba raide.
Il y eut, cette nuit-là, une scène de famille
terrible, car les frères trouvèrent le fatal
billet; ils eurent du mal à arracher à leur
sœur le nom de celui qui l'avait écrit. Enfin,
ils l'obtiennent et, brûlant d'un ardent désir
de vengeance - car ils croyaient encore à une plaisanterie,
- ils courent à la maison du séducteur. Ils
le trouvent dormant fort tranquille.
-
Seniores! dit-il, je l'ai écrit et je le pense. Si
votre sœur le veut, j'aurai l'honneur de l'épouser
demain!
Et la cérémonie se fit le lendemain, au grand
scandale de toute la ville qui escomptait du moins un duel
avec le prétendant si cruellement évincé.
Mais celui-ci se contenta de dire:
-
Mon mariage aurait fait trois malheureux. Il vaut mieux
qu'il n'y en ait qu'un. Ce millionnaire du Honduras montra
par là qu'il eût mérité d'être
aimé si, hélas 1 l'amour était une
affaire de mérite.
*
* *
J'ai
passé un mois à Panama, un mois au Costa-Rica;
j'ai causé avec des hommes politiques du Nicaragua,
du Honduras, du Salvador, du Guatemala. Je crois que je
puis maintenant répondre à la triple question
que je m'étais posée en arrivant dans l'Amérique
centrale :
Les États-Unis prendront-ils ces pays? Dans combien
de temps? Et quels en seront les résultats pour l'Europe?
Oui,
les États-Unis feront la conquête de toute
l'Amérique isthmique, depuis l'isthme de Téhuantépec
jusqu'à l'isthme du Darien, et la conquête
non seulement économique - ce dont tout le monde
ici convient - mais politique. Pour Panama, la chose est
faite. Pour le Costa-¬Rica, dont ils possèdent
déjà le plat pays producteur de bananes, ils
pourront mettre environ cinq ans à acheter pièce
à pièce les hauts plateaux producteurs de
café, et le Costa-Rica sera mangé, comme Panama.
Ensuite ils s'attaqueront à la république
suivante. A cinq ans par république, c'est l'affaire
d'un quart de siècle pour que la bannière
étoilée> constellée de cinq étoiles
de plus, flotte depuis les lacs neigeux du Canada jusqu'aux
forêts tropicales de la Colombie. Passeront-ils par-dessus
le Mexique ou l'engloberont-ils, lui aussi? C'est ce que
je vous dirai quand j'aurai vu le Mexique. Occupons-nous
de l'Amérique centrale.
Le
Costa-Rica, dont je sors, est la plus paisible, la plus
éclairée et par conséquent la plus
solide des cinq républiques. De l'avis unanime, elle
est en avance d'un siècle sur ses voisines. Si celle-là
est à la merci du Yankee, les autres feront encore
bien moindre résistance. Or, le Costa-Rica est perdu.
Qu'est-ce
qu'un pays ? Une maison de commerce. Le Costa-Rica vend
de la banane et du café. Quand derrière chaque
plantation, c'est-à-dire derrière chaque comptoir,
au lieu d'un Costa-Ricien il y aura un Yankee, vous voudrez
bien admettre que la maison de commerce sera devenue américaine.
Les États-Unis affirment ne nourrir aucune ambition
politique; ils promettent de ne pas changer la firme, la
vieille raison sociale de la maison qui, fonctionnant désormais
avec leurs capitaux et à leur profit, continuera
de s'appeler « République de Costa-Rica »;
Cela peut se faire. Cela se fait sur les bords de la Tamise
où tant de vieilles maisons à firme anglaise
appartiennent sous main à des capitaux allemands.
Mais ce qui se fait en Angleterre, dans le pays le mieux
gouverné du globe, ne se fera pas en Amérique
espagnole, dans les pays les plus ingouvernables de la terre,
Qu'ils en aient ou n'en aient point envie, les États-Unis
seront forcés de prendre les rênes des cinq
carrosses qui porteront leur fortune. Les cinq cochers indigènes
sont trop chers et trop querelleurs.
La
conquête économique du Costa-Rica aura eu deux
phases, dont l'une prend fin et dont l'autre commence. Les
forêts malsaines et presque impraticables de la côte
Atlantique étaient pour ainsi dire abandonnées.
Le Yankee les a acquises à bon compte. Il a racheté
la voie ferrée, importé des nègres
de la Jamaïque, établi un service direct de
bateaux fruitiers avec La Nouvelle-Orléans, et la
culture de la banane est devenue une affaire superbe. Maintenant
il va commencer l'attaque des hauts plateaux, où
l'on cultive le café.
Ceux-là
ne sont pas du tout abandonnés. L'hectare de terrain
s'y pèse au poids de l'or. Mais les grands propriétaires
ne demandent qu'à liquider leurs biens pour aller
vivre de leurs rentes en Europe.
C'est
que la vie de château, au Costa-Rica, manque d'agréments.
Tous les domestiques et gens de service sont fainéants,
incapables, insoumis et voleurs. Ne sachant et ne voulant
rien faire, rendant leur tablier à la moindre observation,
on peut dire qu'ils ne restent dans une maison que le temps
d'y trouver à dérober quelque objet, bijou,
argent ou paquet de linge. Le coup fait, ils s'en vont.
Pincés la main dans le sac, ils s'en vont de même,
car les maîtres, connaissant par expérience
l'indulgence des juges, s'épargnent la peine d'appeler
une police négligente, souvent complice.
Même,
ils ne sont pas toujours renvoyés. Le larcin devient
une peccadille sur laquelle on ferme les yeux. Dans le premier
hôtel de San José, la femme de chambre a volé
mes boutons de manchettes, la montre d'un voyageur italien,
les bas de soie d'une dame française. Elle est connue
pour voleuse. Il y a deux ans, elle a été
prise sur le fait. L'hôtelier ne l'en garde pas moins.
Personnellement, il ferme ses tiroirs à clef. Que
ses voyageurs se débrouillent!
Je
suis reçu dans une jolie maison de campagne, au pied
du fameux volcan Irazu, Le jour même de mon arrivée,
disparaît un porte-monnaie oublié un instant
sur la table du salon. On le retrouve dans la malle de la
bonne, une fillette qui avoue en pleurant avoir agi sur
les conseils de la cuisinière et du garçon
d'écurie, avec qui elle devait partager l'argent
dérobé. On les renvoie tous les trois, pour
en prendre d'autres qui ne vaudront pas mieux.
Le
dimanche, les Indiens des plantations sont ivres et se battent
à coups de « machete », sorte de sabre
à l'aide duquel on se fraye un chemin dans les forêts
vierges. Le travailleur noir est plus sobre, mais aussi
fainéant et plus rancunier. Si on le congédie,
malheur au propriétaire ou au régisseur qui
s'attarde, la nuit tombée, au coin d'un bois solitaire!
On le retrouvera avec une balle au milieu du front. L'Indien
vole, le nègre assassine.
Voilà
pourquoi les grands propriétaires du Costa-Rica ne
demandent qu'à convertir leurs plants de café,
leurs champs de maïs et leurs pâturages en bon
argent sonnant qui, dans ces pays neufs, se place en banque
à dix et douze pouf cent. Voilà pourquoi le
millionnaire costa¬ricien volé par ses domestiques
indiens, menacé de mort par ses travailleurs noirs,
n'a qu'un désir au monde: habiter Paris avec cent
mille francs de rente! L'acheteur yankee peut se présenter.
Il trouvera porte ouverte.
Une
fois propriétaire des trois quarts du Costa-Rica
- le quatrième restant au petit paysan indigène-l'Américain
voudra réorganiser les finances et la police. Quand
on se sent chez soi. on veut être maître chez
soi. Ainsi disparaîtra l'Amérique centrale.
Le
président actuel de la République, senior
don Gonzalès Viquez, devant qui je développais
franchement cette opinion, ne la partage pas :
-
« Prendre le Costa-Rica ! Prendre l'Amérique
centrale ! Mais c'est impossible : l'Europe s'interposerait
! L'Europe l'empêcherait ! »
Par
quel moyen ? l’honnête don Gonzalès Viquez
négligeait de me le dire. L'Angleterre et la France
se désintéressent officiellement de cette
partie du monde. L'Allemagne seule y manifeste quelque activité.
Mais je ne vois pas le kaiser déclarant la guerre
à l'oncle Sam pour protéger les petits dictateurs
de l'Amérique centrale.
Certainement,
cette annexion sera mortelle pour les intérêts
européens. Depuis quatre ans qu'ils possèdent
le canal de Panama, les Américains ont progressivement
mais impitoyablement éliminé tout employé,
tout capital non yankee. Partout où ils s'installeront
de même, l'Européen n'aura plus qu'à
boucler ses malles et s'en retourner. Mais qu'y faire?
Consolons-nous,
me dit-on, par l’idée qu'au moins le touriste
européen y gagnera! Il pourra visiter le Costa-Rica,
qui est un des plus beaux pays du monde, et le Guatemala,
non moins splendide, avec le confort que le Yankee introduit
partout à sa suite. Déjà, l'an prochain,
à San-José de Costa-Rica, va s'élever
un magnifique hôtel moderne, tenu à l'américaine.
On ne sera plus condamné à l'extraordinaire,
à l'innommable saleté de l'unique auberge
qui se décore actuellement du titre d'Hôtel
Palace.
C'est
vrai. Tout de même cela console mal l'ancien propriétaire
d'un château, que le nouveau propriétaire l'invite
à venir le visiter agréablement. L'Europe
pouvait être chez elle en Amérique centrale.
Les habitants nous appelaient. La France a préféré
aller au Maroc, l'Allemagne en Turquie, l'Angleterre au
Transvaal, la Belgique au Congo. Elles ont peut-être
eu tort.
Avec
un peu d'ordre, un peu plus de moralité publique
et privée - que la présence de nombreuses
colonies européennes aurait aussitôt introduit
- ces pays fertiles et enchanteurs auraient été
un des paradis de la race blanche.
Le
Yankee saura le prouver.